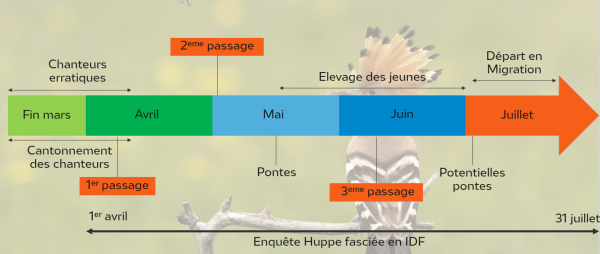Bravo à celles et ceux qui on trouvé nos petits palmés !
Difficile de ne pas s’émerveiller : petits, peu adroits et déjà bien bavards, nos canetons colvert sont prêts pour l’aventure !

Le Canard colvert, Anas platyrhynchos, est l’une des espèces de la famille des Anatidés les plus répandues et reconnaissables à travers le monde. Avec de faibles exigences d’habitat, il fréquente une grande variété de milieux humides, qu’il s’agisse de petites mares saisonnières ou de vastes plans d’eau, de cours d’eau étroits ou de larges rivières, tant stagnants que courants. Les deux bassins du parc François Mitterrand ont l’air de lui convenir parfaitement !


Cette espèce présente un dimorphisme sexuel marqué. Les mâles, appelés « colverts », arborent un plumage aux couleurs vives, avec une tête vert métallique, un collier blanc distinctif et un corps gris-brun. Leurs ailes exhibent des marques bleues et blanches éclatantes lorsqu’elles sont déployées en vol. Les femelles, quant à elles, sont plus discrètes, avec un plumage brun tacheté pour se camoufler dans leur environnement lors de la nidification .
Attention les canards ne mangent pas de pain !
Il est un oiseau avec un régime alimentaire varié et profite des opportunités qui se présentent à lui. Omnivore, ce canard se nourrit de graines et de végétaux divers, mais ne néglige pas pour autant les petits animaux aquatiques qu’il est susceptible de trouver. En effet, son bec est capable de filtrer des proies de petite taille !

Les couvaisons du colvert commencent dès les mois de février et de mars. Elles durent en moyenne une trentaines de jours. Leurs nids sont généralement en marge de l’eau, à l’abri d’une éventuelle montée des eaux. On les trouvera à même sol, soigneusement dissimulé parmi les herbes sèches, les touffes végétales et les buissons bas.
Dès leur deuxième mois nos petits canetons pourront voler à leur guise !
Sources
Canard colvert – Anas platyrhynchos (oiseaux.net)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Canard colvert-Présentation (mnhn.fr)