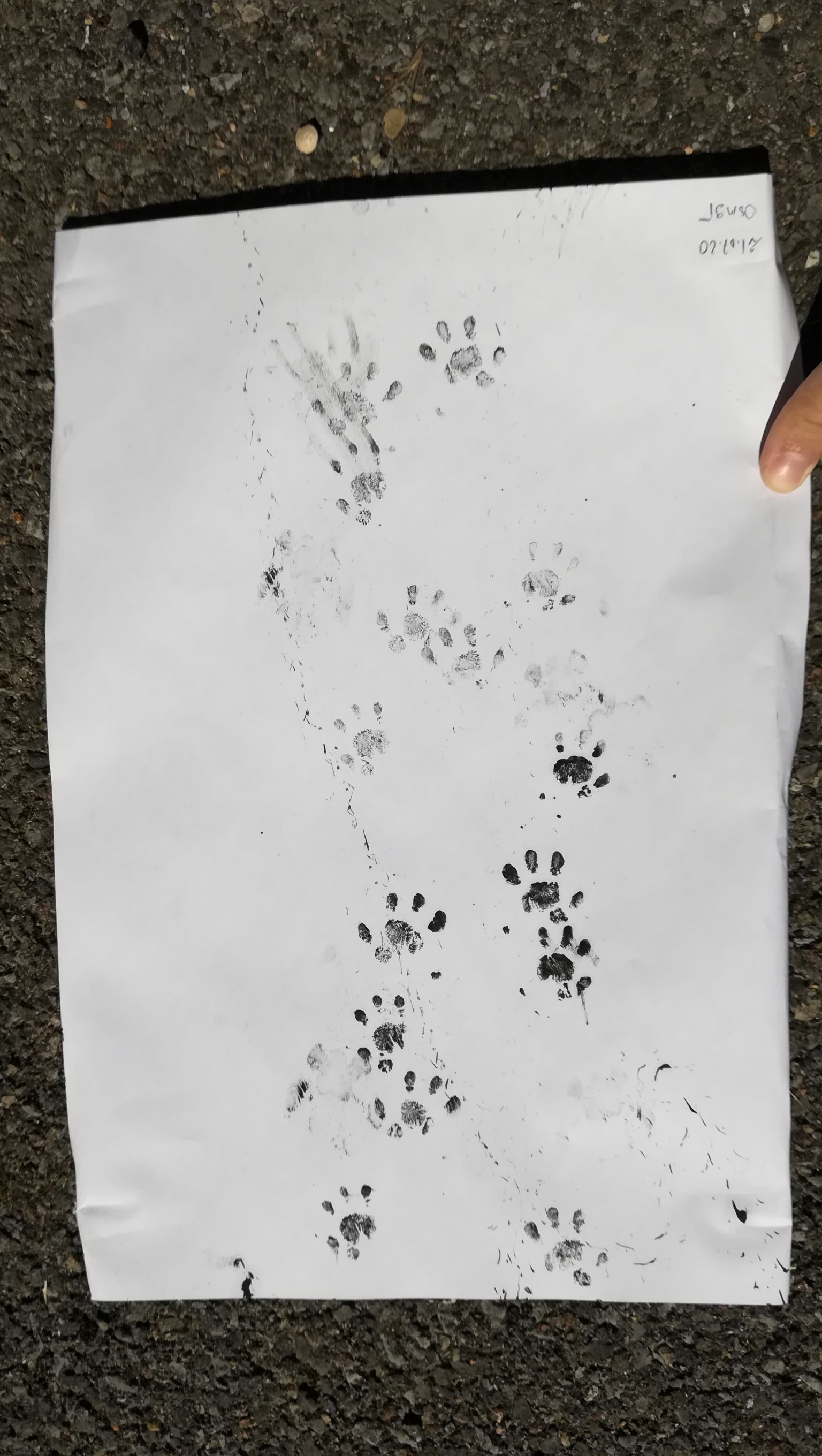Bien vu ! Cachée sous les lentilles d’eau, c’est bien une grenouille verte qui profite du soleil au bord de la mare Bicourt à Courdimanche.

En réalité, c’était plutôt 40 grenouilles vertes qui se réchauffaient sur les bords de l’eau. En voilà déjà 7 !

On parle plus facilement du complexe des grenouilles vertes. Car en plus de se cacher sous les lentilles, les espèces de grenouilles vertes sont très difficiles à différencier les unes des autres. Et s’hybrident !
Les deux espèces de base sont la grenouille de Lessona, une petite grenouille indigène en France, et la grenouille rieuse, bien plus grande, qui était cantonnée au nord est du pays et a été largement introduite sur tout le territoire. Leur hybride s’appelle la grenouille comestible, ou grenouille verte commune. Et à part le chant, il y a peu de critères bien visibles pour les différencier.
Malheureusement, à l’heure de la sieste, celles-ci étaient bien silencieuses. Contrairement à celles vues dans la mare des Larris en 2019, qui sont donc cette fois plutôt des grenouilles rieuses.
En termes de probabilités on s’orientera donc vers l’hybride, la grenouille verte commune pour nos 40 individus de la mare Bicourt.
Quelque soit l’espèce, on rappelle que les amphibiens sont tous protégés à l’échelle nationale ; et que les migrations et reproductions sont en cours, prenez garde aux traversées de route de ces petites bêtes ! Si vous trouvez un amphibien sur la route évitez de le toucher à mains nues pour le ramener sur le bas côté. Privilégiez les gants voire l’utilisation d’objets naturels (branches, feuilles) pour le toucher.