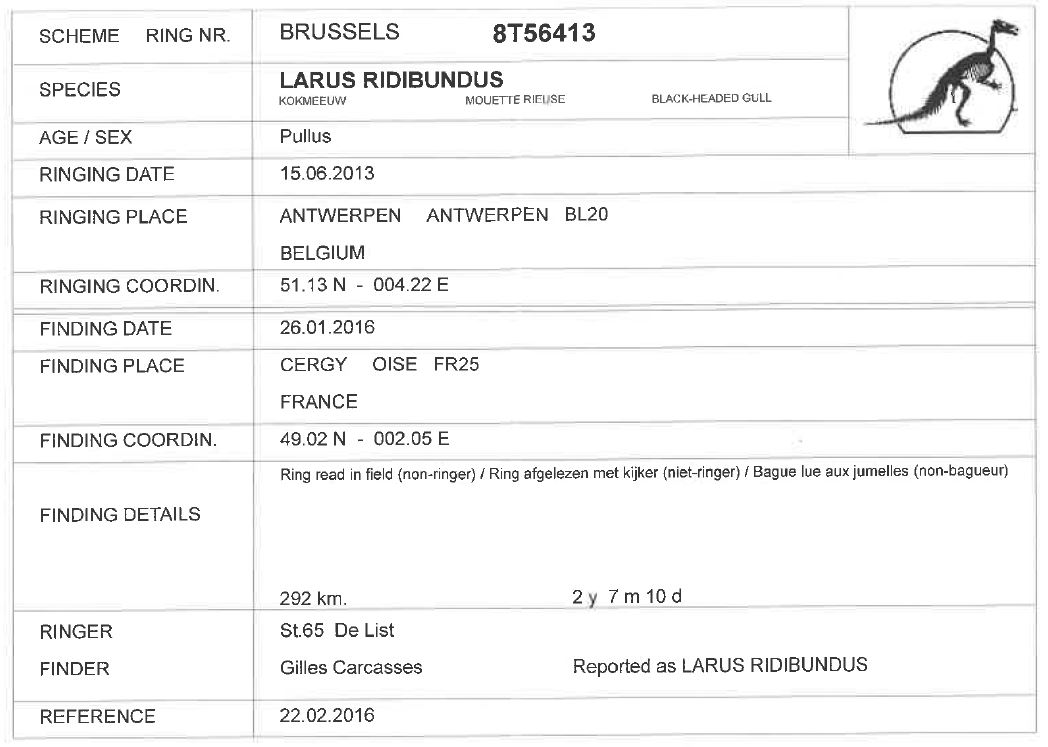Qu’est ce que c’est que cette forêt de chandelles sur le terre-plein central de l’avenue de l’Hautil à Cergy ? Cette fois-ci ce n’est pas une idée du paysagiste, comme les Eucomis qui fleurissent au même endroit. Cette plante est venue là toute seule et elle se régale ! C’est Orobanche hederae, qui parasite le lierre.


Les orobanches puisent l’eau et les substances nutritives dont elles ont besoin dans les racines de leurs plantes hôtes.
On peut rencontrer en Ile-de-France 11 espèces d’orobanches dont la plupart sont rares :
- Orobanche alba (AR) sur le thym précoce et le clinopode commun,
- Orobanche amethystea (PC) sur le panicaut champêtre,
- Orobanche arenaria (RRR) sur l’armoise champêtre et le genêt des teinturiers,
- Orobanche caryophyllacea (R) sur les gaillets,
- Orobanche gracilis (R) sur différentes fabacées,
- Orobanche hederae (AR) sur le lierre,
- Orobanche minor sur (R) les trèfles,
- Orobanche picridis (PC) sur les picris, les crepis et aussi les carottes,
- Orobanche purpurea (R) sur l’achillée millefeuille,
- Orobanche rapum-genistae (RR) sur le genêt à balais,
- Orobanche teucrii (AR) sur les germandrées.
N’ayant pas besoin de synthétiser leurs sucres, elles ont abandonné la photosynthèse. Voilà donc des plantes qui ne sont pas vertes, étant dépourvues de chlorophylle. D’autres plantes parasites ont cette même particularité, c’est le cas en Ile-de-France des lathrées (également de la famille des Orobanchaceae), des cuscutes (Convolvulaceae), des monotropes (Ericaceae), de la Néottie nid-d’oiseau (Orchidaceae).

Les monotropes parasitent les conifères.
Certaines plantes parasites sont aussi chlorophylliennes, comme le gui, les euphraises, les mélampyres, les odontites, les pédiculaires, les rhinanthes. Rappelons que le lierre, malgré ses crampons, n’est pas une plante parasite.