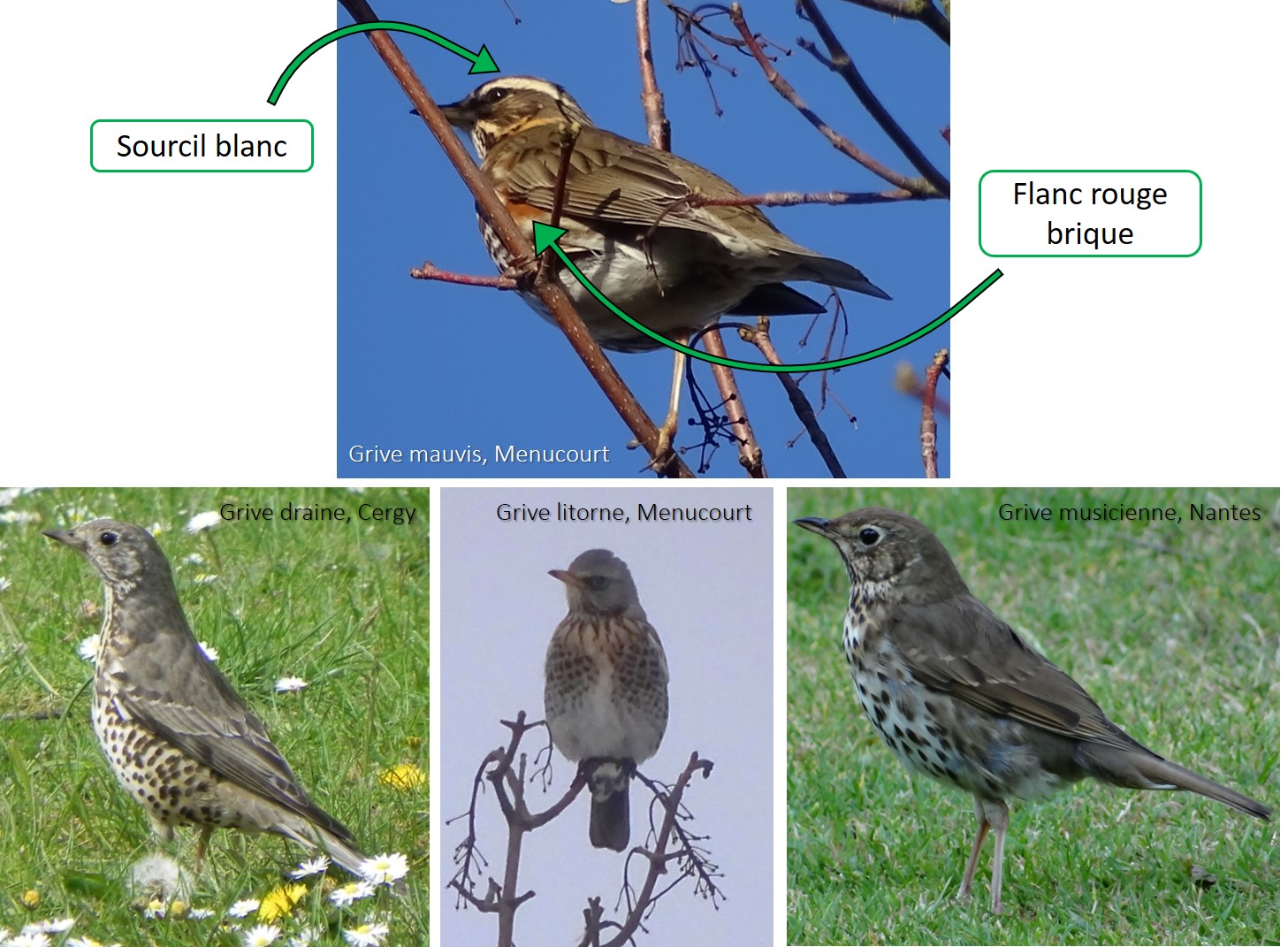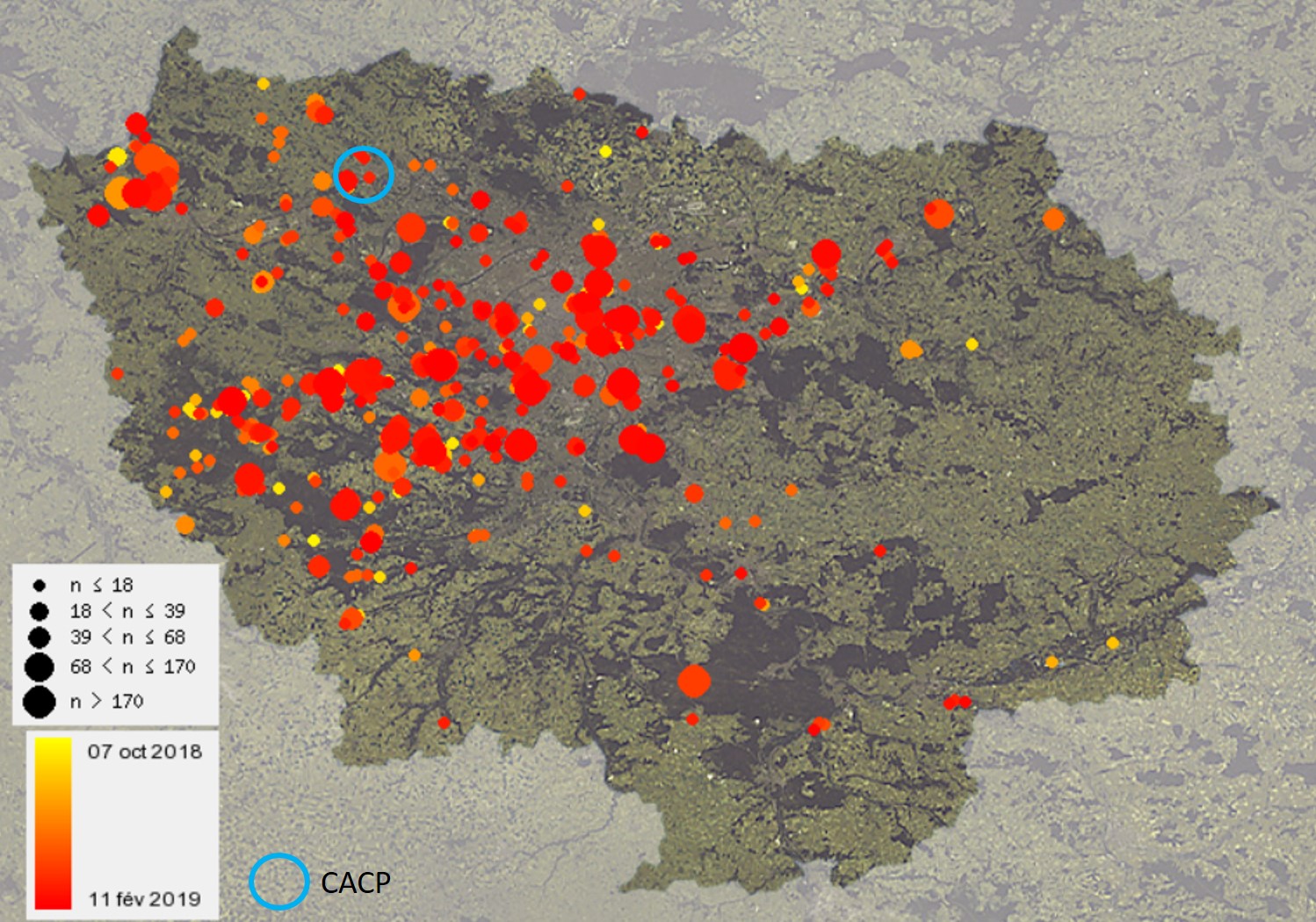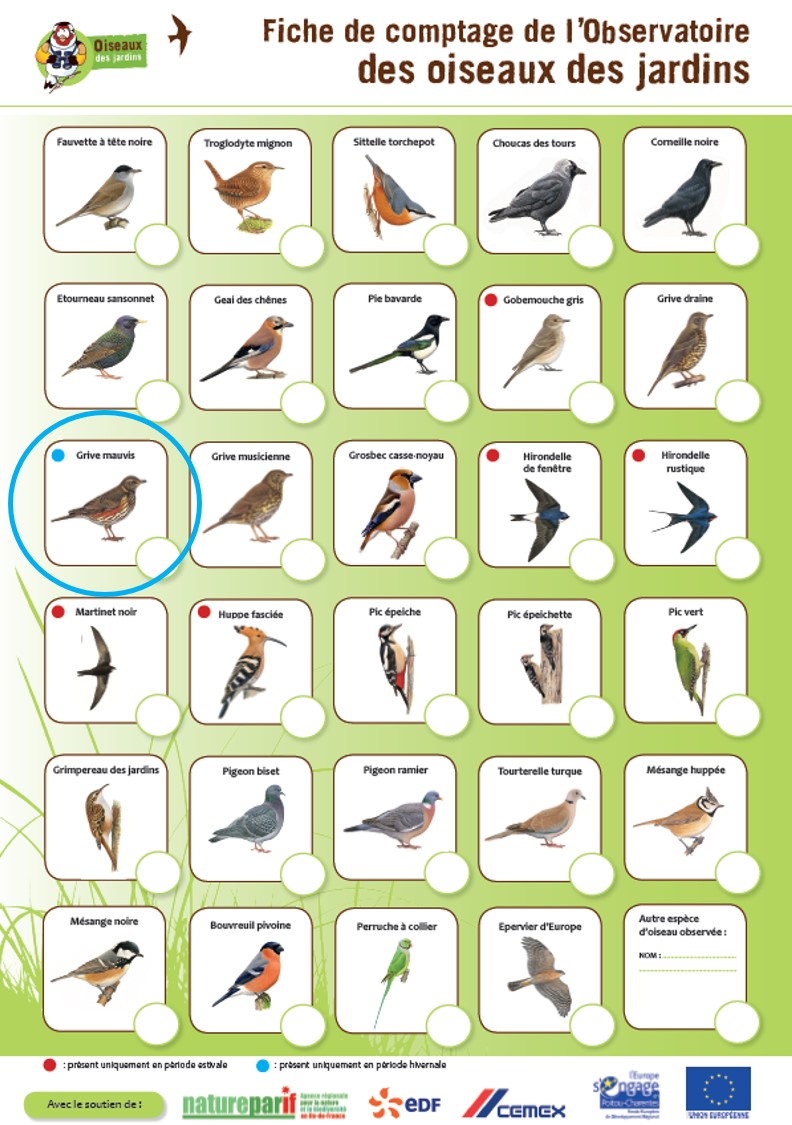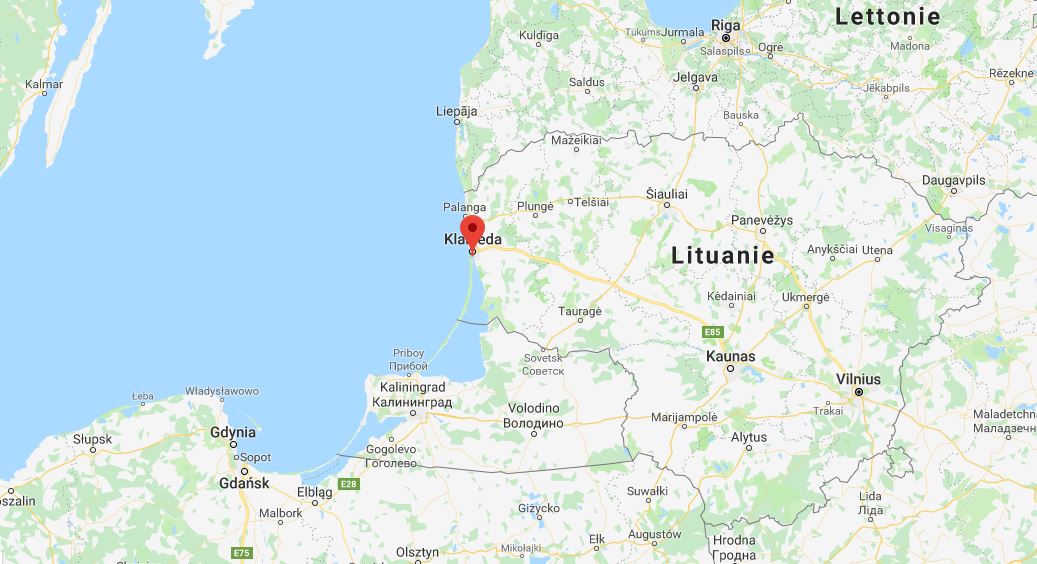L’ail des ours est de retour ! Cette plante vivace des sous-bois humides émet en effet ses feuilles dès la mi-février.
On peut cuisiner cette sauvageonne au fin goà»t d’ail. Mais il faut se méfier des confusions, car les feuilles d’autres plantes apparaissent aussi dans les mêmes milieux à la sortie de l’hiver.

Les feuilles comme les fruits des arums sont très toxiques. Selon le centre anti-poisons de Lille, les arums arrivent en 5ème position des cas d’intoxication par des plantes. Ce sont essentiellement leurs baies rouges, tentantes pour les jeunes enfants, qui sont en cause.

Les feuilles de l’orchis mâle (Orchis mascula) sont ordinairement tachetées de noir mais parfois, comme ici, certains pieds ne présentent pas ce caractère.
Le muguet, toxique, peut être particulièrement trompeur car ses feuilles ont une forme très semblable à celles de l’ail de l’ours. Il pousse cependant plus tard en saison.

Il convient de bien vérifier sa récolte : chaque feuille doit nettement sentir l’ail. Ensuite, il faut laver soigneusement les feuilles.
Pour faire l’omelette à l’ail des ours, deux œufs et cinq feuilles ciselées par convive suffisent. Ces feuilles se prêtent à bien d’autres recettes, elles peuvent par exemple être utilisées pour aromatiser une sauce à la crème en accompagnement d’une viande blanche ou d’un poisson.
Pour éviter le risque des confusions, on peut aussi trouver des graines d’ail des ours en jardinerie et cultiver cette plante dans son jardin.