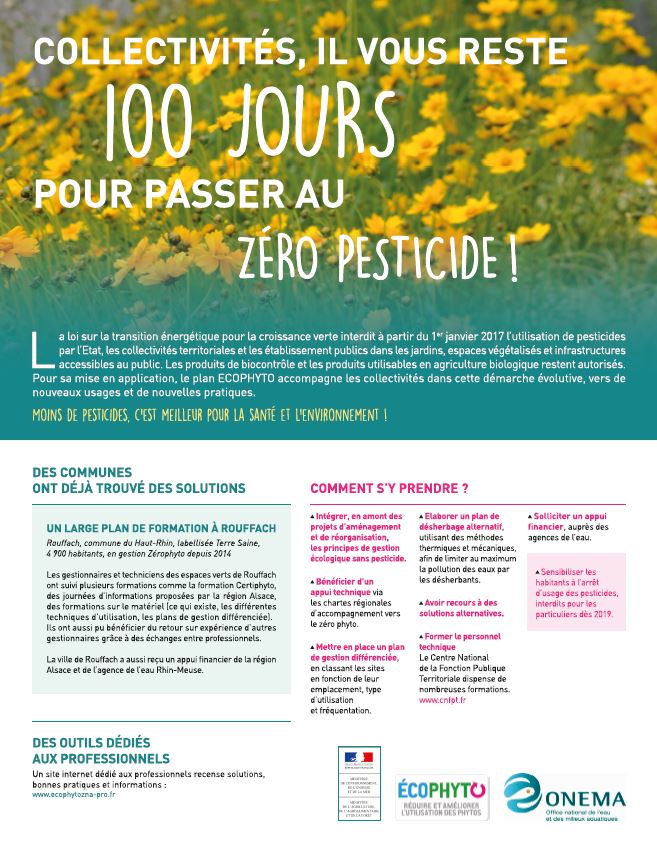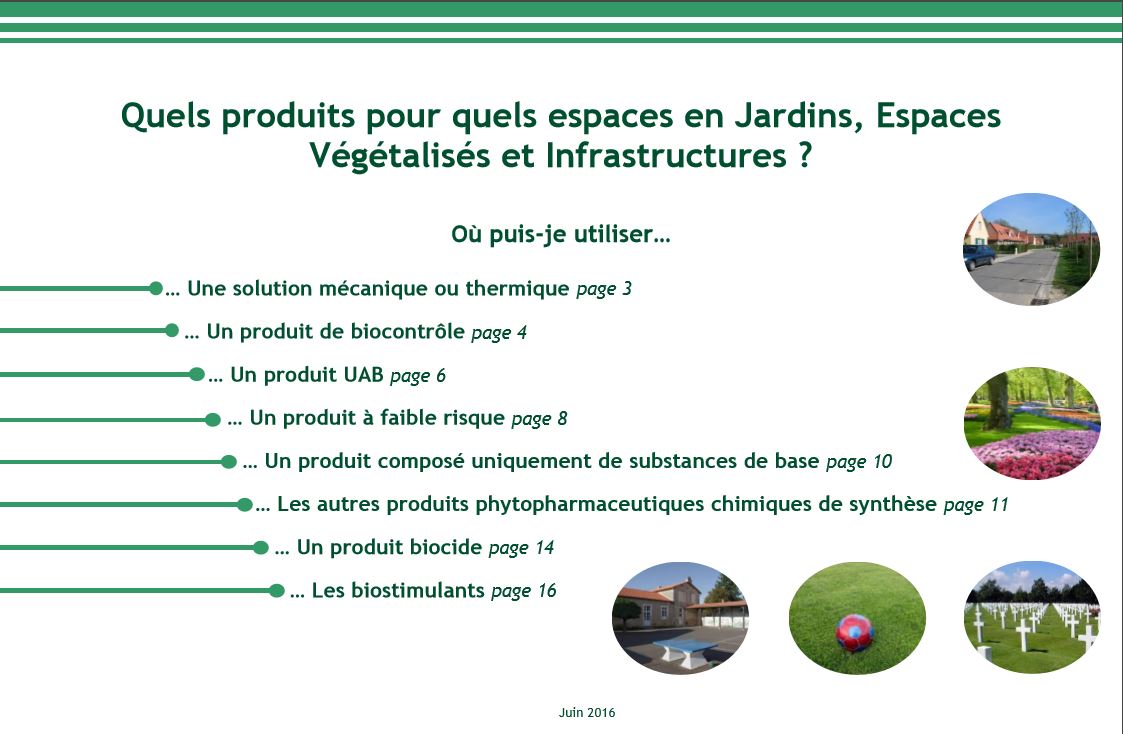Un poulailler à roulettes place des Arts ? C’était à l’occasion de la manifestation « A la rencontre de Cergy-Pontoise en transition » organisée par la Bibliothèque d’Etude et d’Information de Cergy-Pontoise, samedi 24 septembre 2016. Les poules ont eu beaucoup de succès.
Elles m’ont écrit une lettre, je vous la livre dans son jus :
Bonjour,
Tous les midi et tous les soirs dans un cageot on nous trimbale, du poulailler à la prairie de l’Ecole des Châteaux. ils ont même fabriqué un piège pour qu’on rentre dans le cageot la prairie c’est chouette.
Pour notre anniversaire, 4 mois ça ce fête, nous sommes parti place des Arts, à la bibliothèque. C’était le jour de la terre celle qui nous nourrit, les grandes ont pondu 2 œufs. Nous n’avons même pas eu le temps d’aller bouquiner un livre sur les poules car nous avons eu beaucoup de petits et grands admirateurs.
Signé : Les poules
Ces poules-là sont lettrées car, vous l’aurez compris, ce sont les mascottes de l’école Les Châteaux à Cergy. Souvenez-vous, elles avaient déjà fait les vedettes lors de leur fameuse transhumance-spectacle du 5 juillet 2016.