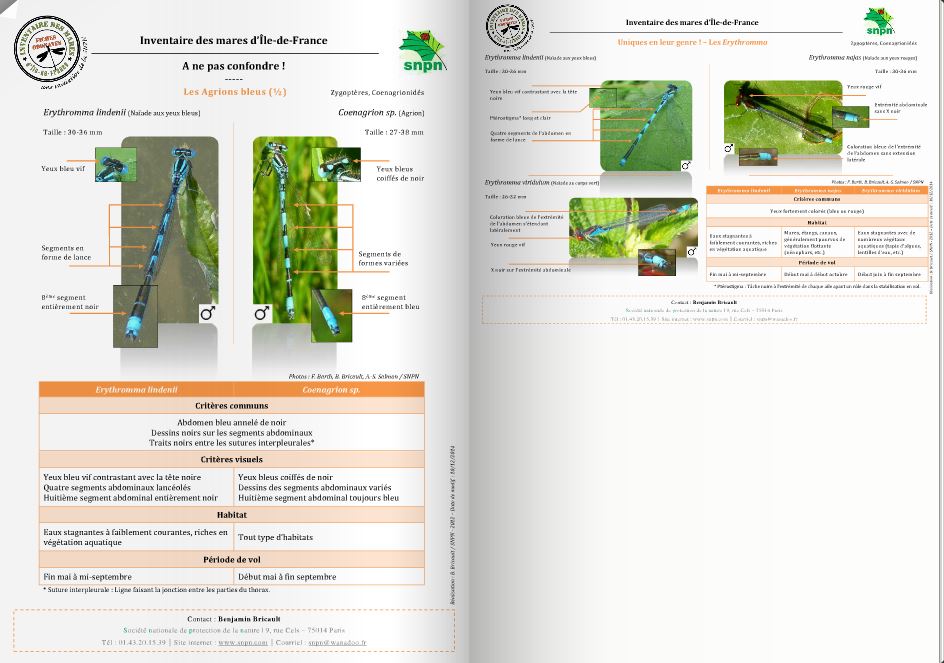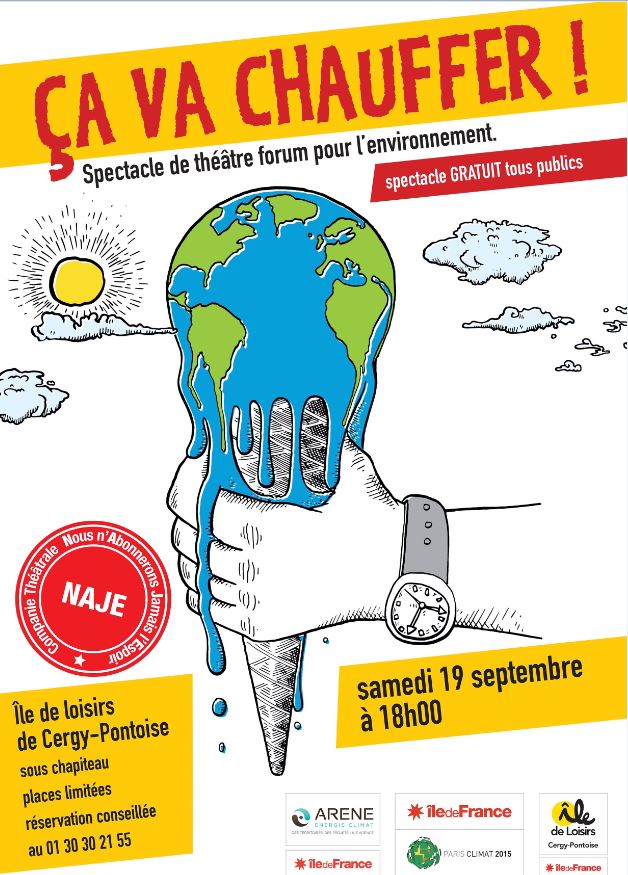Sans doute pour protéger ces jolies fleurs blanches, un radar de feux tricolores a été installé à proximité de ce carrefour près de la gare de Neuville-Université. Ainsi à l’abri des assauts des grosses broyeuses du service d’entretien des routes, gênées par ce poteau dans leurs manœuvres, ces plantes refleurissent chaque année et se ressèment spontanément.

La plante a fière allure avec ses envolées de fleurettes d’un blanc brillant. Le gaura (du grec gauros qui signifie fier) est depuis quelques décennies très en vogue dans les jardins publics, dans les massifs fleuris traditionnels comme dans les massifs de plantes vivaces. Il existe de nombreuses variétés horticoles de cette plante : à fleurs roses, à port plus ou moins trapu… Cette onagracée d’origine texane n’est pas difficile, elle supporte parfaitement la sècheresse et le calcaire, mais elle craint l’excès d’humidité.

Je l’ai vue timidement apparaître là , dans l’herbe, au printemps 2011.
Que fais-tu là l’américaine ?
La présence à ses côtés de quelques tulipes laissait soupçonner un apport de terre ou de déchets de jardin. Les tulipes ont disparu, mais les gauras se sont bien installés.

Cette petite population de gauras s’est un peu étoffée au fil des années. La persistance depuis 2011 de cette plante non indigène lui vaut selon moi un statut local de plante subspontanée. (On peut dire aussi « diaphyte ergasiophygophyte », ça fait son effet dans les conversations)
Assistons-nous à la naissance d’une nouvelle plante naturalisée pour l’Ile-de-France ?
Il faudrait pour cela que trois conditions soient réunies : sa persistance pendant 10 ans, une descendance importante et confirmée par semis naturel, un essaimage hors de son périmètre actuel.
Cette plante est absente de la flore d’Ile-de-France de Philippe Jauzein et Olivier Nawrot qui fait référence pour la région parisienne. Elle a été signalée subspontanée en Suisse, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Midi-Pyrénées. Elle aurait franchi le cap de la naturalisation en Australie.