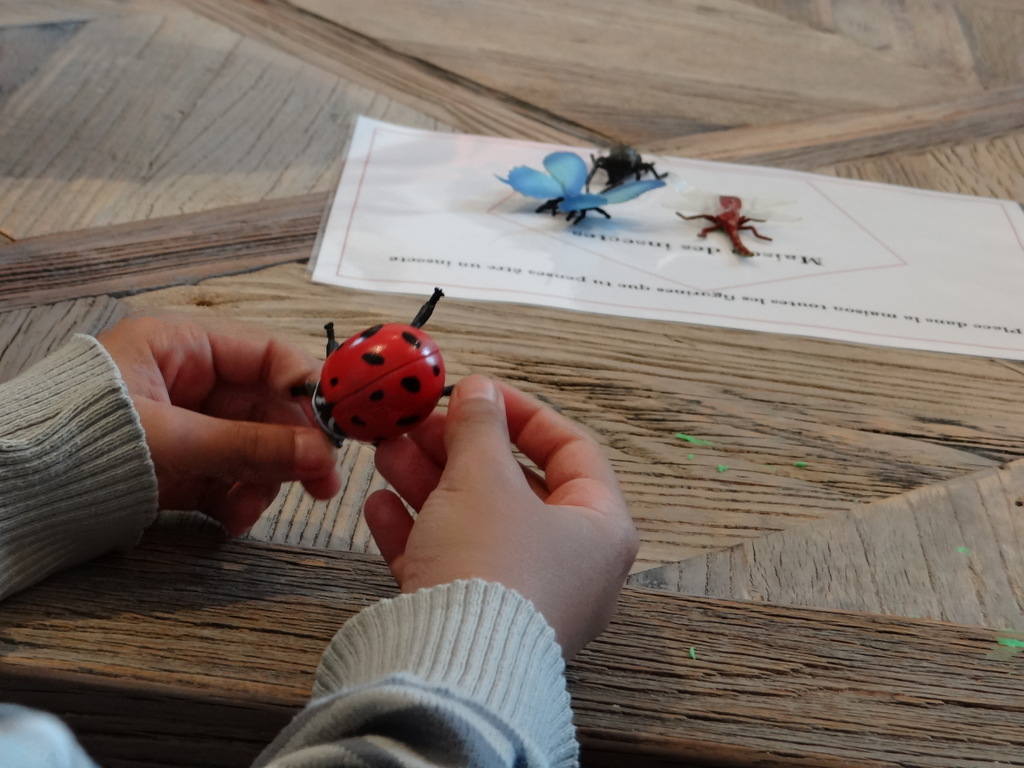Le laccaire améthyste a un pied trop fibreux pour être consommé. On peut facilement confondre les exemplaires peu colorés de cette espèce avec deux champignons toxiques de petite taille également, Mycena pura et Inocybe geophylla lilacina. Donc, la plus grande prudence s’impose !

Le cortinaire violet n’est pas très fréquent. Cette belle espèce affectionne les hêtres. Il est fortement déconseillé de consommer des cortinaires car certaines espèces de cette famille sont très toxiques. On aperçoit à mi-hauteur de son pied des fibrilles sombres et allongées qui sont les restes de la cortine qui unissait le chapeau au pied, dans la jeunesse de ce champignon. Attention : ce détail n’est pas toujours très visible. Au moindre doute : à rejeter ! Mieux, n’y touchez pas, c’est une espèce rare.

Le pied bleu est un champignon de fin de saison au goà»t fruité pas très délicat. Certaines personnes le digèrent mal. Et il a, dit-on, la capacité de concentrer le plomb et les nucléides radioactifs.
Alors, si vous voulez régaler votre famille sans prendre de risques, vous trouverez au marché d’excellents champignons de couche. N’oubliez pas que chaque année des ramasseurs de champignons imprudents décèdent en France pour avoir consommer leur récolte. Et d’autres en gardent de graves séquelles invalidantes. Bon appétit.