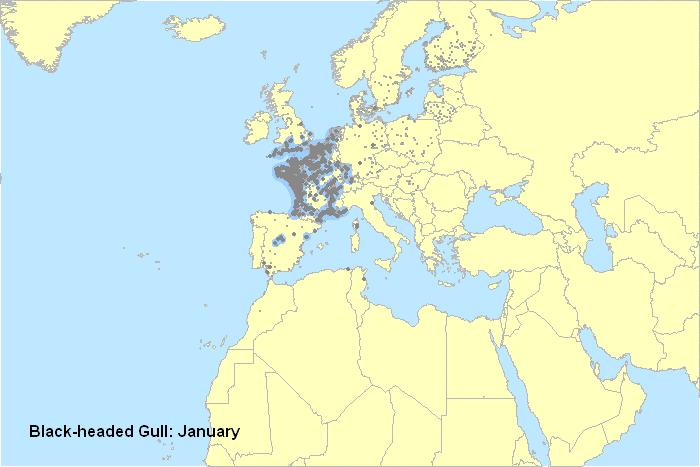Invisibles mais belles !

Elles se font discrètes avec leurs couleurs ternes et leurs sorties nocturnes, pourtant les Noctuidae, ou noctuelles en français, sont la famille de papillons la plus riche en France. Plus de 830 espèces ! Parmi les 156 espèces identifiées dans le Val d’Oise par nos collègues naturalistes, nous en avons photographié une vingtaine sur Cergy-Pontoise ! En voici quelques-unes.
Les chenilles
La très grande majorité des noctuelles sont phytophages (elles mangent des végétaux). C’est d’ailleurs pour ça qu’elles sont le plus connues. La plupart sont inféodées à une espèce de plante pour la nourriture des chenilles, et quelques-unes d’entre elles ont des goà»ts assez proches des nôtres : tomate, chou, artichaut, maà¯s, betterave, salade… Elles ne se font pas beaucoup d’amis chez les agriculteurs, d’autant que certaines sont capables de dévorer une grande diversité de plantes.

Les chenilles des noctuelles, comme les adultes ont souvent des couleurs variant du vert au gris, voire au marron.

La logique voudrait que les chenilles marron vivent au sol et se nourrissent des parties basses des plantes (on dit qu’elles sont terricoles) et que celles qui vivent dans les feuilles soient vertes, pour se camoufler et échapper aux prédateurs. C’est très souvent le cas, mais certaines espèces font des fantaisies…

Les adultes
Après avoir passé l’hiver sous forme de chrysalides dans le sol, les adultes émergent et vivent quelques jours (de 2 à 10 selon les espèces) afin de se reproduire. Ils ne se nourrissent alors plus que de nectar et participent à la pollinisation.

Leurs teintes vertes et marron leur permettent de se fondre assez bien dans la végétation et leur activité étant essentiellement nocturne, il n’est pas aisé de les repérer.


Vues de près, leurs ailes sont souvent ornées de jolis motifs. Avez-vous déjà rencontré des noctuelles à Cergy-Pontoise ? Faites-nous part de vos découvertes !
Le Jour de la Nuit
 Les noctuelles, comme les autres animaux nocturnes, peuvent être perturbées par la pollution lumineuse. Ce weekend, le 12 octobre 2019, a lieu une journée (et une nuit!) de sensibilisation aux problèmes causés par la pollution lumineuse et aux solutions que l’on peut y apporter.
Les noctuelles, comme les autres animaux nocturnes, peuvent être perturbées par la pollution lumineuse. Ce weekend, le 12 octobre 2019, a lieu une journée (et une nuit!) de sensibilisation aux problèmes causés par la pollution lumineuse et aux solutions que l’on peut y apporter.
Un petit geste pour nos amis nyctalopes ? Commencez par visiter le site internet de la manifestation !
Sources :
Les Noctuidae, par Ephytia de l’INRA
Les Noctuidae, par Insecte.org
Pour en savoir plus sur la biodiversité nocturne :
Une conférence de l’Agence Régionale de la Biodiversité en àŽle-de-France