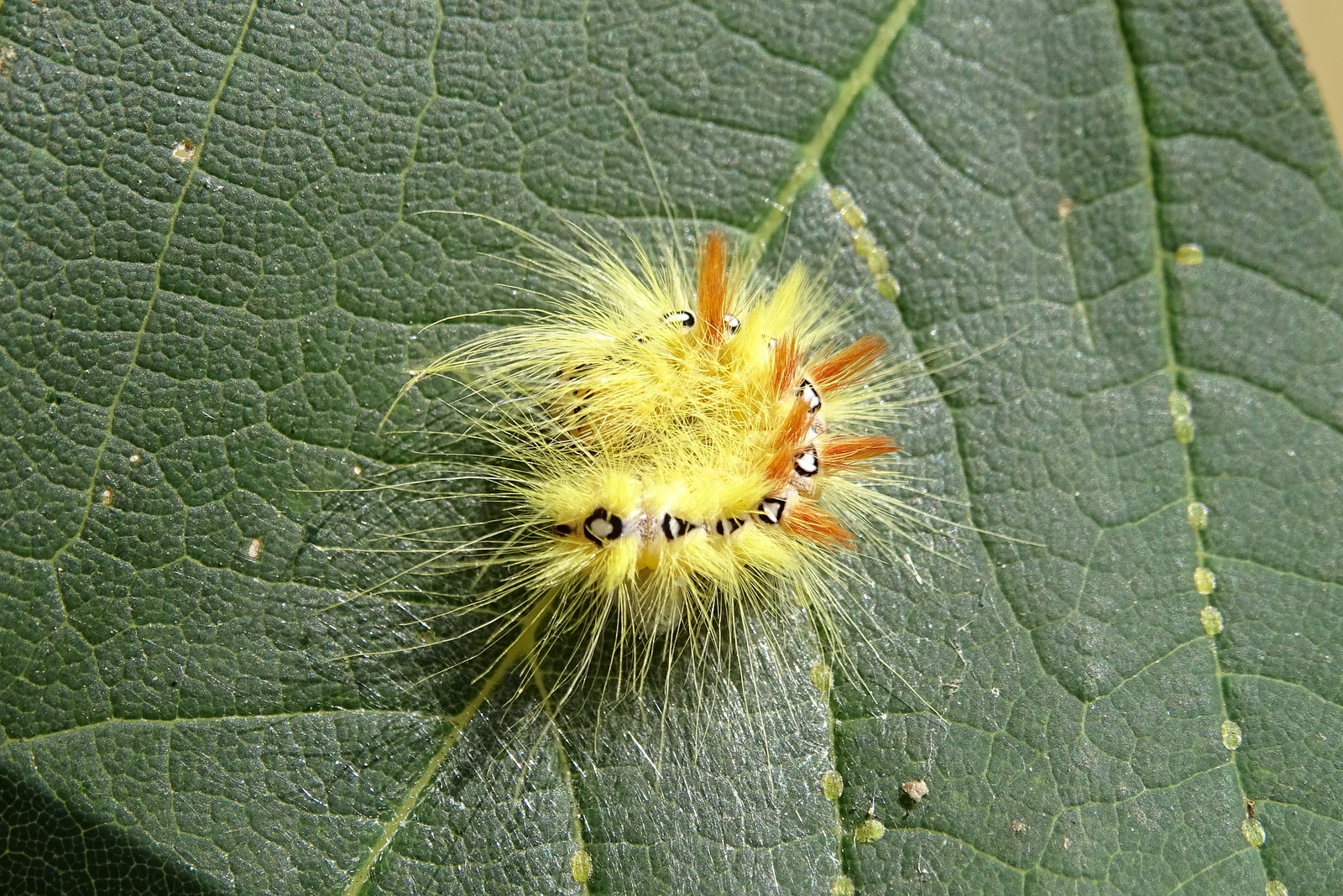Une chenille redoutée par les jardiniers

Au revers d’une feuille de chou, les œufs de la piéride ont éclos, donnant naissance à de minuscules chenilles. Avant de partir à l’aventure et dévorer le chou, elles consomment le chorion de l’œuf (la « coquille ») pour se donner des forces.
Sur la capucine, aussi

On rencontre parfois des chenilles de la piéride du chou sur la capucine, sans doute apprécient-elles la saveur piquante de ses feuilles, proche de celles des Brassicacées, comme la moutarde, la ravenelle et le chou qui font leur ordinaire.

Il existe en Ile-de-France quatre espèces de Pieris. Sur la photo ci-dessus, il s’agit de Pieris brassicae, la piéride du chou, très fréquente dans les potagers. Elle est reconnaissable à la tache noire à l’apex de l’aile antérieure qui est étendue sur les deux bords. A gauche, c’est le mâle, sa tache apicale est plus fine que celle de la femelle.
Cette espèce est bivoltine, c’est-à -dire que deux générations se succèdent dans l’année. On voit les papillons de première génération en avril, mai et ceux de la seconde en juillet, aoà»t.
Les parasitoà¯des, solutions naturelles de biocontrôle
Un hyménoptère parasitoà¯de du genre Apanteles (famille des Braconidae), présent naturellement dans les jardins, peut réguler efficacement les pullulations des chenilles de piérides. Il pond dans les jeunes chenilles. Ce parasitoà¯de-ci observé sous une feuille de chou à Vauréal pondait directement dans les œufs de la piéride :

Retrouvez nos articles :
Papillons des jardins, des prairies et des champs
Biocontrôle, nouvelle approche du jardin
Dans cet article Le bouillon blanc de Neuville, un autre parasitoà¯de de la piéride du chou
Sources :
Piéride du chou, par Jardiner Autrement
La piéride du chou par André Lequet
Pieris brassicae, par l’Atlas des papillons de jour et des zygènes d’Ile-de-France (Cettia)