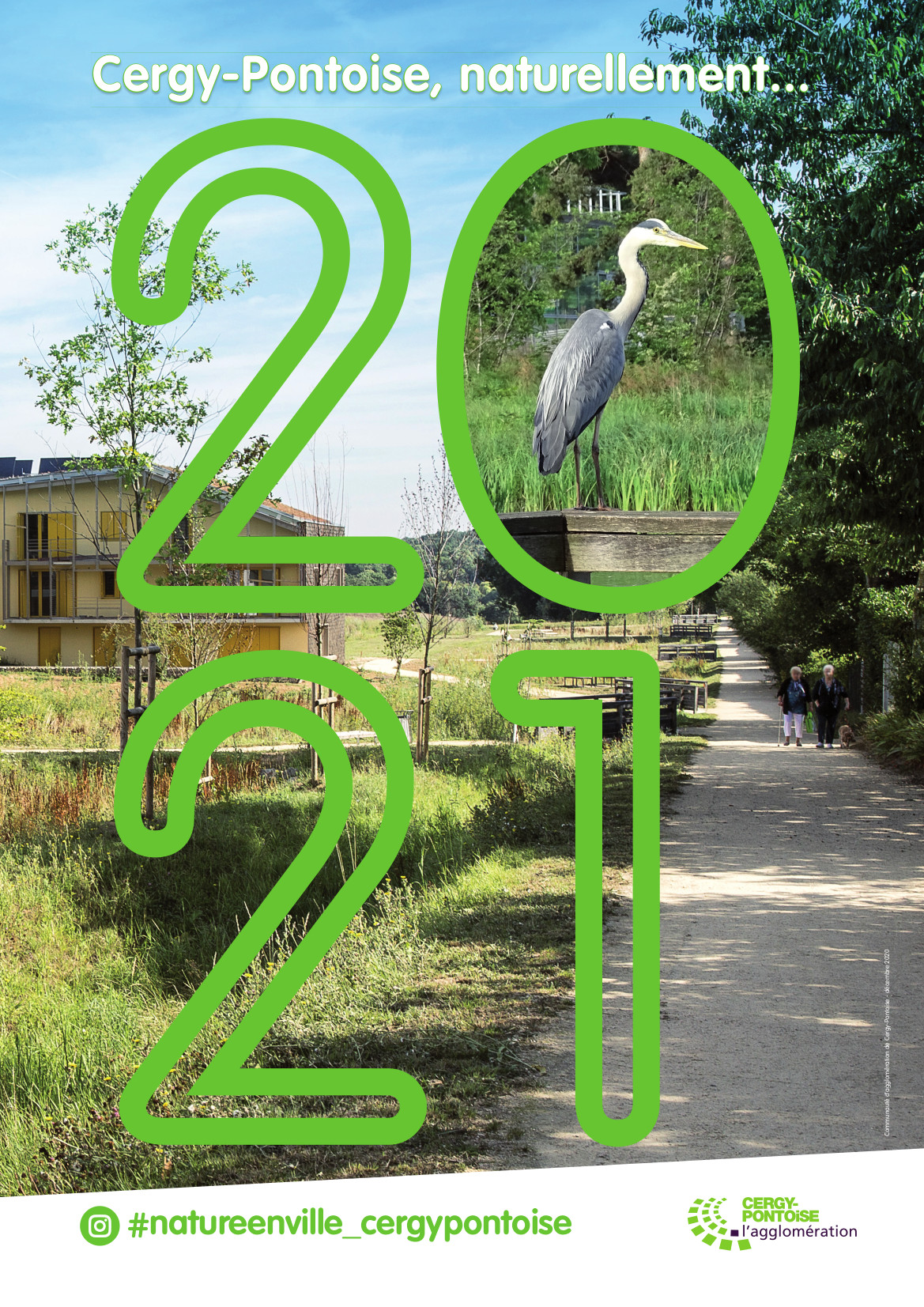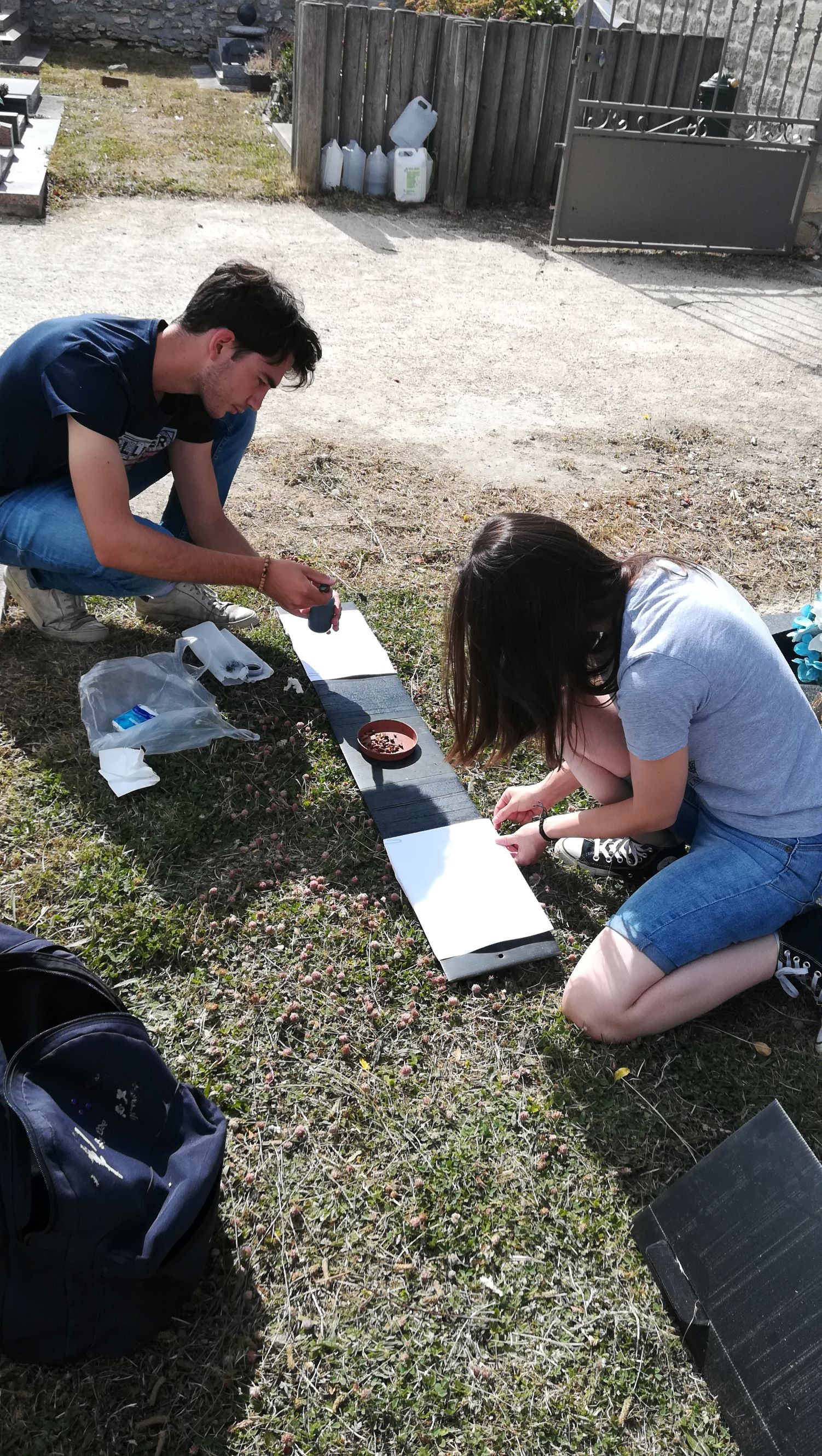Bravo à Franck qui a reconnu tout de suite la circée de Paris, de la famille des Onagracées ! La voici, bien vivante cette fois, dans les bois autour de la ferme d’Ecancourt.

L’élégance parisienne
Notre mystérieuse plante aime la fraicheur des milieux plutôt humides et les jeux de lumières des zones ombragées qui mettent en valeur sa floraison délicate. Très commune dans la Région on la retrouve dans presque tous les boisements humides, comme ici, dans le parc de Grouchy.

Elle présente un look tout en sobriété : plante d’une vingtaine de centimètres seulement, portant une inflorescence en grappe aérée, de petits fruits ornés de poils crochus et des fleurs sur un modèle 2. C’est en effet l’une des très rares plantes de nos contrées à n’avoir que deux pétales ; deux petits cœurs blancs se faisant face autour des pièces fertiles de la fleur.

Des histoires de sorcières
Pourtant, malgré son apparence inoffensive, son nom est évocateur. Si lutetiana fait référence à Paris (Lutèce) et à sa présence fréquente en France, Circea renvoie à Circée la célèbre magicienne de la mythologie grecque. Parait-il que c’est cette plante que Circée utilisa dans la potion qui transforma Ulysse et ses compagnons en cochons (d’Inde, selon les versions) !

D’autres affirment que Herbe aux sorcières, nom qu’on lui donne à l’occasion, est un dérivé de « sourcière » qui lui correspond bien puisqu’on la trouve essentiellement en milieu humide.
Mais méfiance tout de même, elle n’est pas comestible. Elle est fortement tanique et cette histoire de métamorphose n’est pas totalement élucidée …
Sources :
La flore d’àŽle-de-France, par Philippe Jauzein et Olivier Nawrot
Le portrait de la circée par Sauvage du Poitou