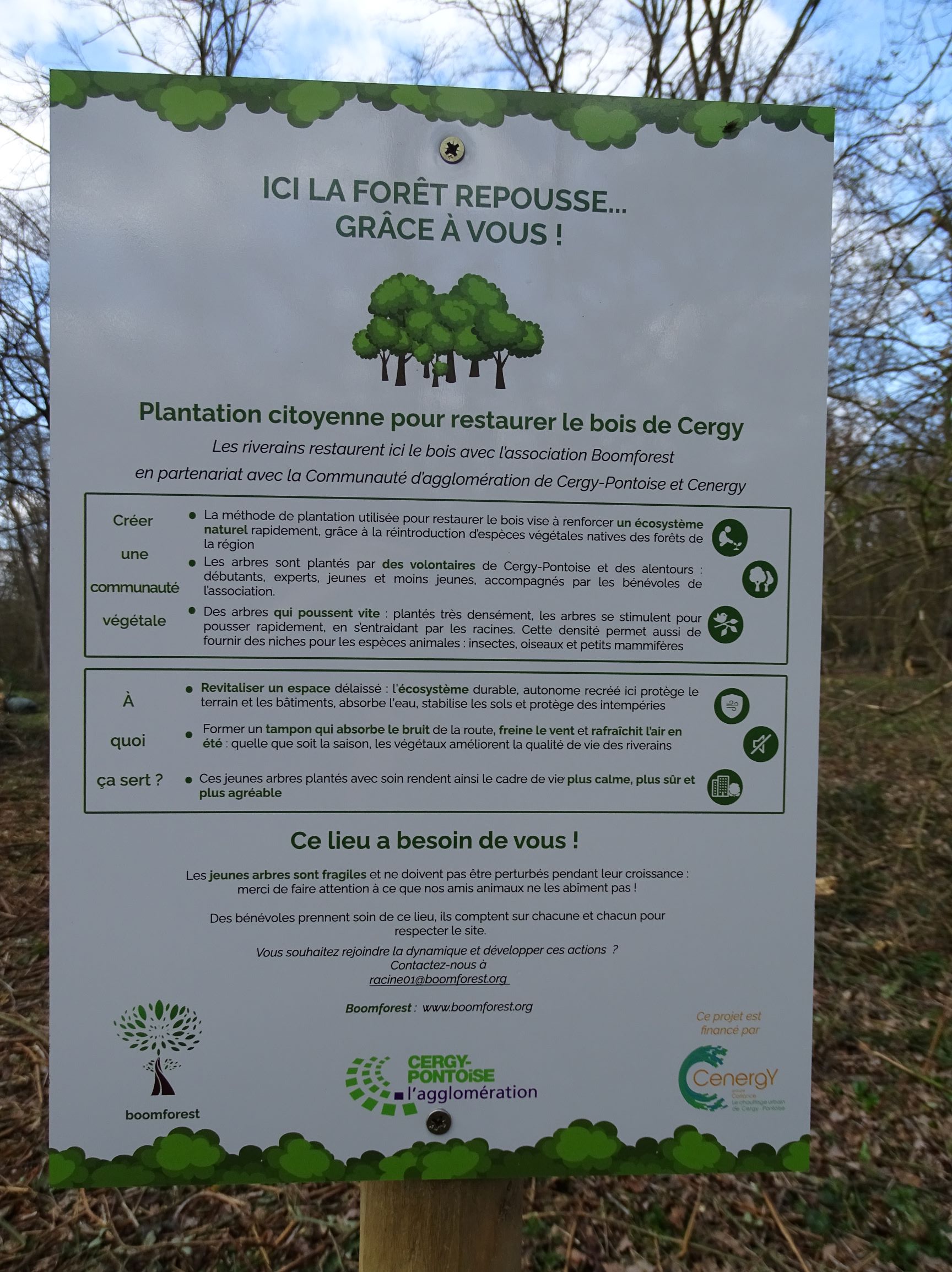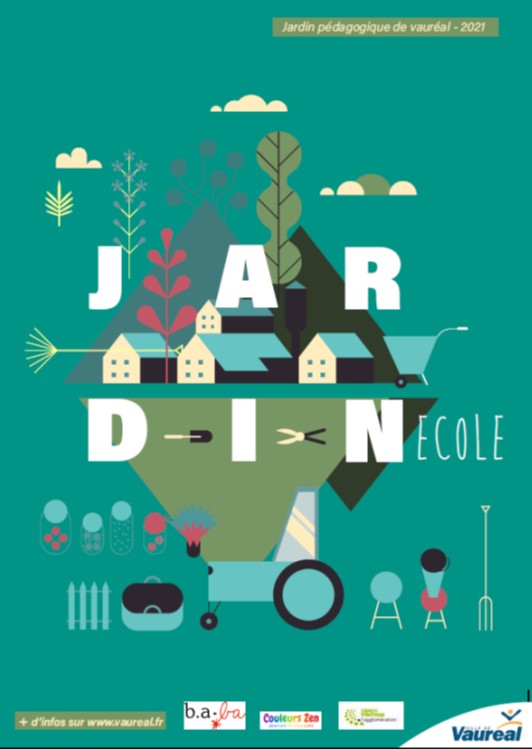Il était une fois Monsieur et Madame Colvert (Honorine et Gaston de leurs prénoms), un couple de canards qui habitaient sur les bords des bassins du parc François Mitterrand. C’est donc sur ces bassins qu’ils donnèrent naissance, en 2019, à quatre petits canetons. Mais comme l’hiver 2018-2019 avait été relativement doux, les quatre canetons sont nés très tôt dans l’année, au début du mois de février. Or, à cette période, pour éviter le gel des appareils d’alimentation des bassins, les pompes sont à l’arrêt et les coursiers sont vides.
Patatras ! Un matin, les quatre petits canetons ont suivi leur maman et sont descendus dans les coursiers.

Mais sans eau, ces bassins sont bien trop profonds pour que nos quatre petits amis, qui ne savent pas encore voler, puissent sortir tous seuls. Leur maman est bien embêtée, elle ne va tout de même pas les abandonner là …
Heureusement, est passé par là le grand Léo qui, de sa main secourable, a sorti les quatre petits canetons des coursiers qui ont vite rejoint leur maman.

Morale de cette histoire, au début de cette année les services du secteur GEMAPI ont pris les devants et ont installé dans tous les coursiers des rampes à canetons !

Ces bastaings de bois installés dans chaque coursier devraient permettre aux canetons, ou à d’autres petits animaux (comme les hérissons) ayant chu dans les bassins de remonter sans peine. Les pigeons les ont essayés et c’est validé !
Retrouvez des images de l’installation sur la page Facebook de l’agglomération