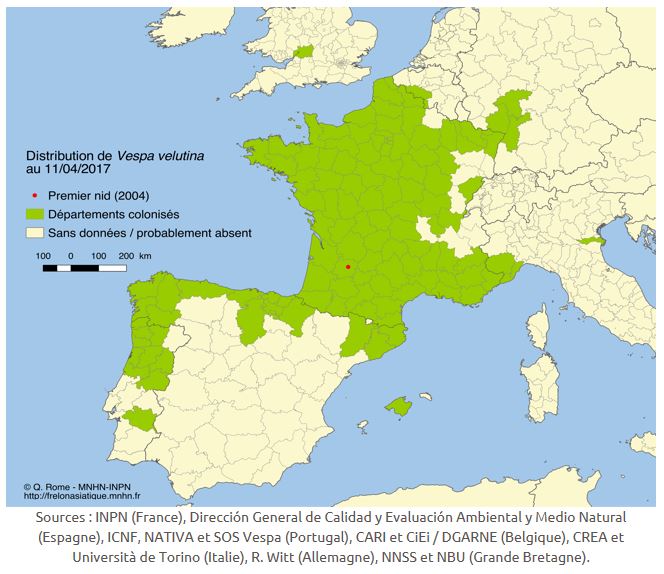En récoltant mes noisettes pourpres, j’ai observé que les involucres très enveloppants de ces fruits offraient de bons abris à plein de petites bêtes. J’ai entrepris de les photographier. Mon rendement de cueilleur de noisettes en a gravement pâti.


Voici l’impressionnant mais très inoffensif « perce-oreilles ». J’en ai vu très peu cette année.

Ectobius vinzi, une petite blatte de jardin qui devient très commune et rentre parfois dans les maisons, sans faire aucun dégât (il suffit de la remettre dehors). Cet immature est facile à reconnaître avec sa barre blanche transversale.

Une araignée crabe arboricole de la famille des Philodromidae.

Tiens ! Un Oulema, coléoptère ravageur des céréales qui grignote aussi les graminées sauvages.

Un look incroyable celui-ci avec ses antennes en bâton et ses pattes antérieures très élargies ! Asiraca clavicornis est un homoptère Delphacidae.
Au jeu des noisettes-surprises, on trouve une bien intéressante biodiversité ! J’y retournerai sà»rement et vous posterai mes autres découvertes…