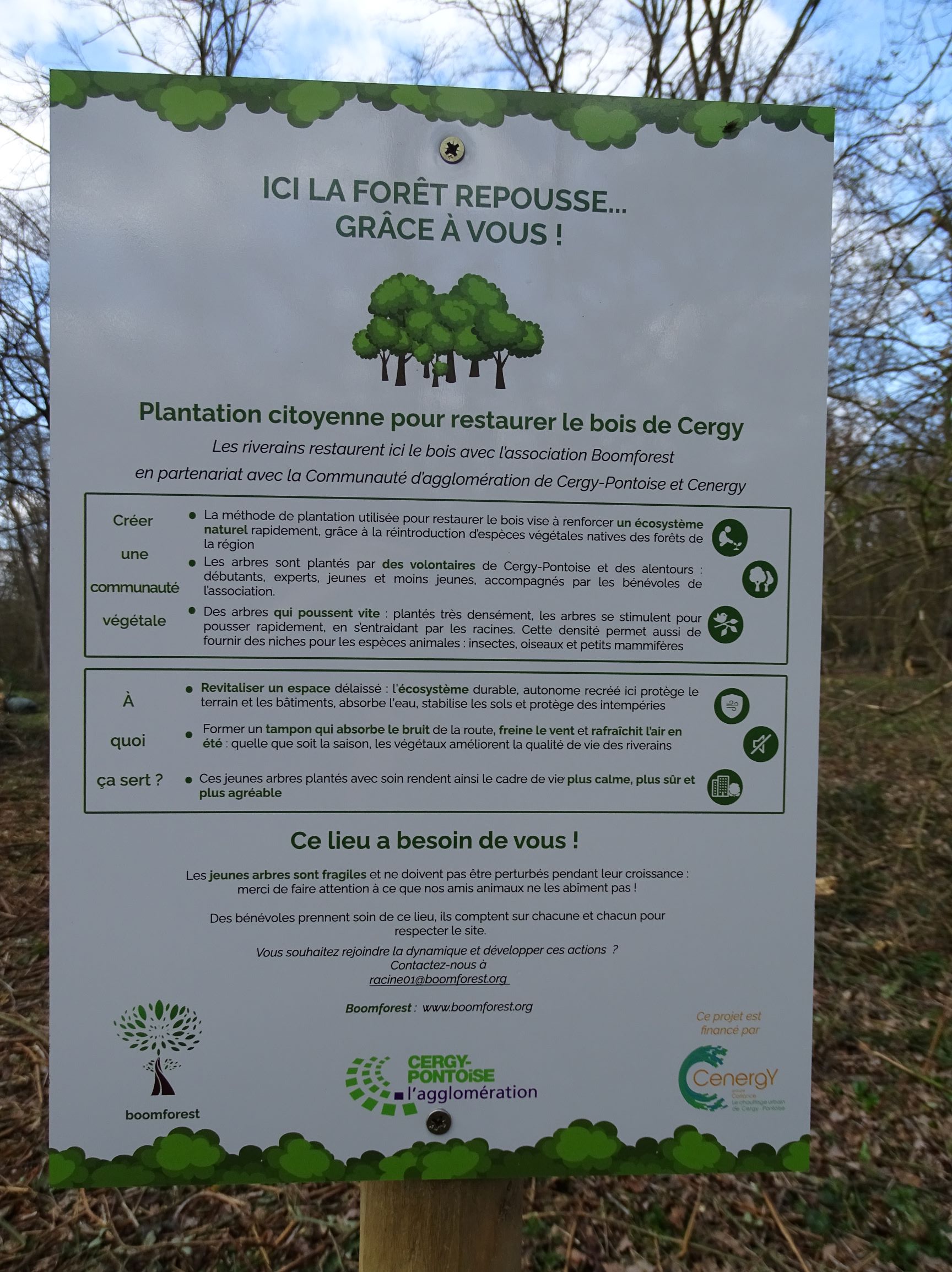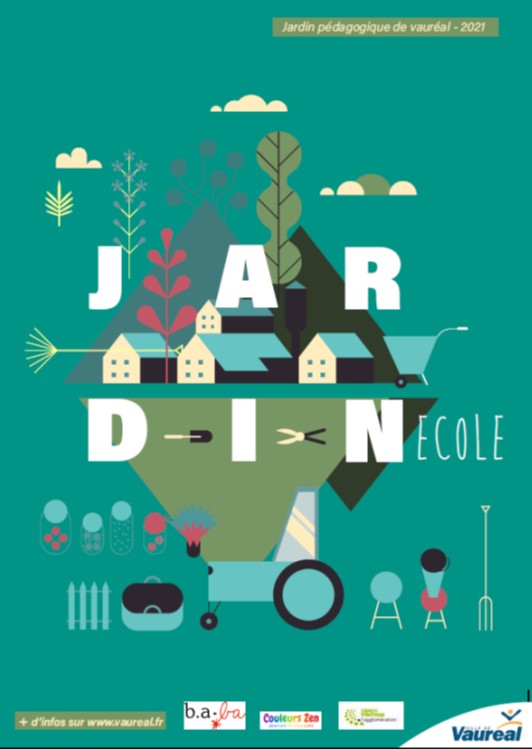Aux bords des étangs de l’île de loisirs les aulnes ont commencé à fleurir. Les chatons mâles pendent aux côtés des fruits (en cône) de l’an passé. L’effet est assez graphique.

Mais il y a autre chose dans cet arbre. Des petites boules jaunes, dans un aulne, serait-ce… mais oui ! Ce sont bien des tarins des aulnes qui profitent des graines encore présentes dans les cônes femelles de l’arbre pour faire un bon repas.

Le tarin des aulnes, Carduelis spinus, est un petit passereau granivore de la famille des Fringillidae. On reconnait les oiseaux de cette famille à leur bec fort, fait pour casser des graines, leur queue échancrée et leurs couleurs souvent vives. Le tarin est lui dans les tons jaunes et blancs, striés de noir. On reconnaît ici un mâle avec sa poitrine d’un jaune prononcé et sa calotte noire.

Le tarin des aulnes est un oiseau nordique. On ne le rencontre que l’hiver chez nous, où il se nourrit principalement des graines d’aulne ou de bouleau. Dans le Nord de l’Europe, où il niche, il affectionne les conifères.
Sources :
Le guide ornitho, édition Delachaux
Le tarin des aulnes, par Oiseaux.Net