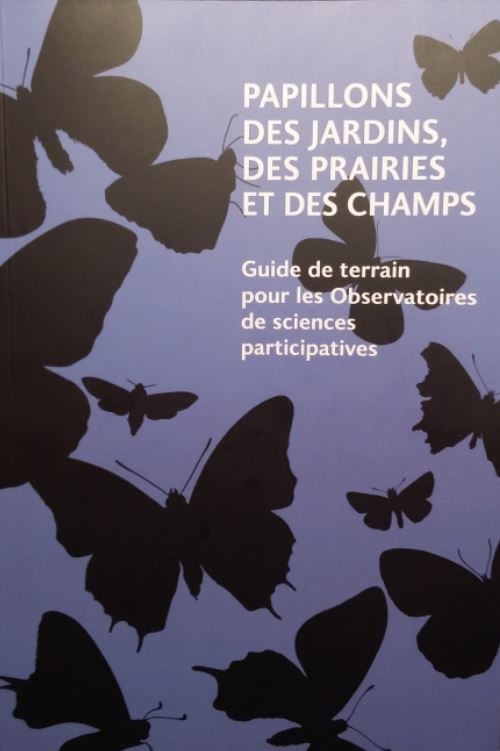Au bord du bassin qui recueille les eaux de toiture de ma maison, j’ai trouvé cette mouchette élancée, immobile sur une tige fasciée de lysimaque. Avec son museau pointu, elle a un look de Sciomyzidae, ces diptères des milieux humides dont les larves consomment des escargots.

Perchée sur un fruit de lysimaque, elle me montre la ligne de cinq gros points noirs qui orne son aile, ce qui permet de la déterminer. Hydromya dorsalis est spécialisée dans les mollusques aquatiques. J’aurais préféré qu’elle s’occupât des escargots du potager…
Il existerait en France 67 espèces de Sciomyzidae, en voici quelques-unes :

Ce sombre Sepedon sphegea, vu au parc François-Mitterrand à Cergy, parasite aussi des mollusques aquatiques.

Limnia unguicornis est spécialisée dans les mollusques terrestres. Remarquez chez cette espèce les yeux à rayures et les antennes ornées d’un cil blanc.

Trypetoptera punctulata, aux ailes joliment décorées, est une autre espèce de Sciomyzidae qui parasite des mollusques terrestres.
Retrouvé un autre article sur les Sciomyzidae :